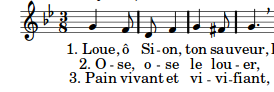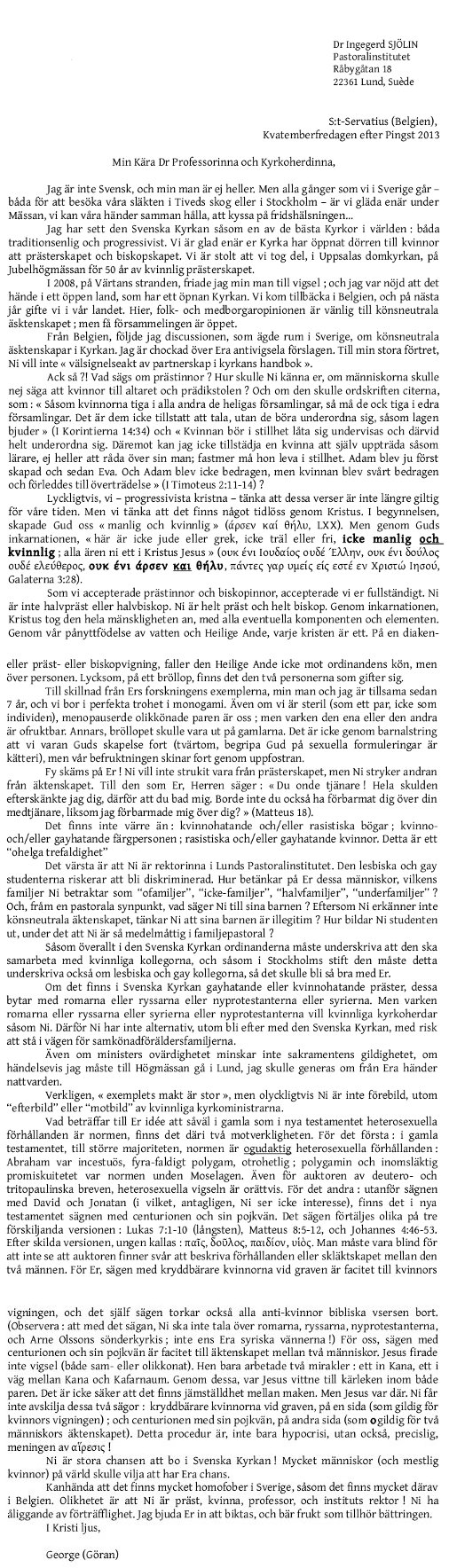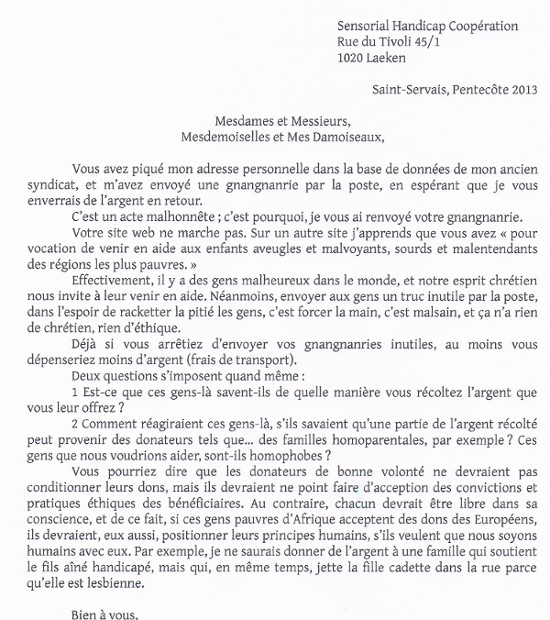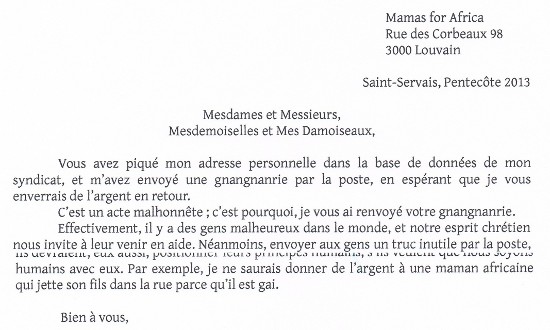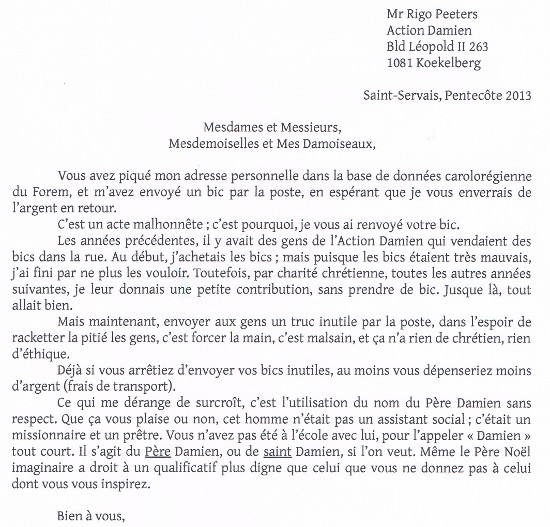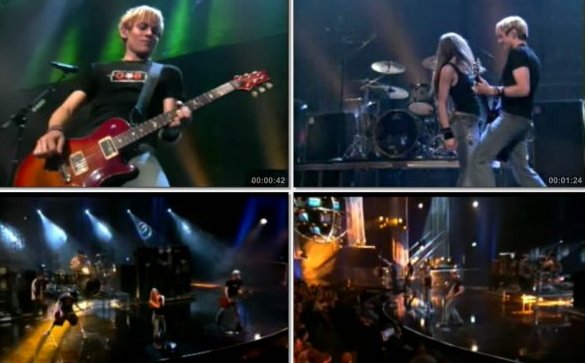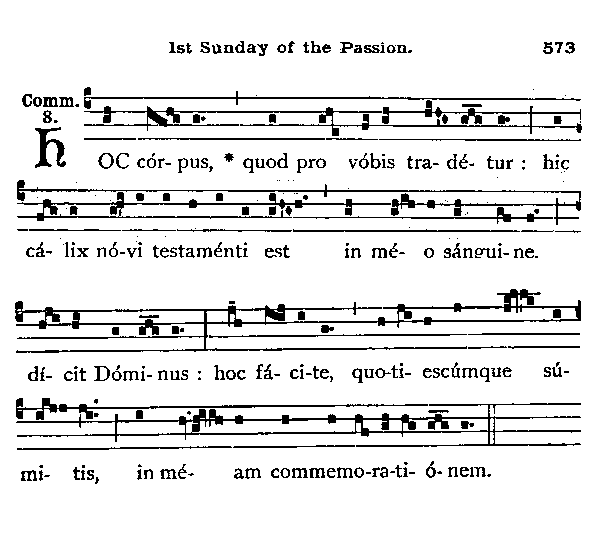 «Mais le pape Urbain IV […] Ce pontife a laissé à l’Église un monument de lui que tous les siècles révéreront. C’est l’Institution de la Fête du saint Sacrement, à l’occasion d’un Miracle qui arrive dans un Village auprès d’Orviette, une Hostie ayant jetté (sic!) du sang pour confondre l’incrédulité du prêtre qui célébroit la Messe. Saint Thomas d’Aquin, qui étoit pour lors Professeur en Théologie à Orviete, composa l’office de cette fête.» (Bossuet)
«Mais le pape Urbain IV […] Ce pontife a laissé à l’Église un monument de lui que tous les siècles révéreront. C’est l’Institution de la Fête du saint Sacrement, à l’occasion d’un Miracle qui arrive dans un Village auprès d’Orviette, une Hostie ayant jetté (sic!) du sang pour confondre l’incrédulité du prêtre qui célébroit la Messe. Saint Thomas d’Aquin, qui étoit pour lors Professeur en Théologie à Orviete, composa l’office de cette fête.» (Bossuet)
Ce n’est donc ni à Salzinnes, ni au Mont-Cornillon que la fête a été institué, malgré la fierté des Belges. (Toutefois, la fête de la Trinité et son office nous viennent d’Hugues de Lobbes!) J’ai déjà parlé ailleurs des implications théologiques de la Fête-Dieu.
Serait-il possible de compiler une Messe de la vigile de la Fête-Dieu? Bien sûr!
Introït: «Qui manducat meam carnem» – voir le jeudi après le 2e dimanche du carême. Verset: «Domini est terra», de la veille de Noël.
Après le Kyrie, la collecte du vendredi après le 4e dimanche du carême: «Deus, qui ineffabilibus mundum renovas sacramentis: præsta, quæsumus; ut Eccesia tua et æternis proficiat institutis, et temporalibus non destituatur auxiliis».
Première prophétie: Zacharie 9:9-17.
Graduel: «Parasti in conspectu meo mensam», du 2 août, ayant comme verset «Dominus regit me».
Gloria, puis une seconde collecte: «Quæsumus, omnipotens Deus: ut inter eius membra numeremur, cuius corpori comunicamus et sanguini» – voir le samedi après le 3e dimanche du carême.
Seconde prophétie: Malachie 1:6-11.
Alléluia, 2e ton. «Dominus regit me» – voir le samedi avant le dimanche de la Passion.
Ou bien: alléluia du 3e dimanche du temps pascal: «Cognoverunt discipuli Dominum Iesum in fractione panis.»
Évangile: Jean 6:27-55: «In illo tempore, dixit Iesus turbis Iudæorum: Operamini non cibum, qui perit, sed qui permanet in vitam æternam.»
Offertoire: «Panis, quem ego dedero, caro mea est pro sæculi vita.» – voir le vendredi des quatre-temps du carême.
Secrète du premier mardi du carême: «Munera tibi, Domine, oblata sanctifica».
Comme antienne de communion, on pourrait prendre «Hoc corpus», emprunté au dimanche de la Passion.
Postcommunion du samedi après les cendres: «Cælestis vitæ munere vegetati.»
Les femmes, les gens de couleur et les LGBT ont été opprimés, et le sont toujours, dans beaucoup d’endroits dans le monde.
Comment réagir, lorsqu’on fait partie de l’une de ces trois catégories, mais que l’on est opprimé par une autre de ces trois?
Il n’y a pas pire que:
1. une femme homophobe ou/et raciste;
2. un(e) gai/lesbienne misogyne ou/et raciste;
3. un(e) noir(e) homophobe ou/et misogyne.
C’est la « trinité perverse ».
L’autre jour j’ai appris que cette dame a critiqué les mariages sexuellement neutres. Le pire, c’est qu’elle est elle-même prêtre et directrice de l’Institut théologique de Lund!
Donc je lui ai écrit:
 Tant qu’on est encore dans l’octave de la Pentecôte (plus exactement le vendredi des quatre-temps d’été), je voudrais vous partager deux réflexions: sur l’épiclèse et sur l’octave de la Pentecôte.
Tant qu’on est encore dans l’octave de la Pentecôte (plus exactement le vendredi des quatre-temps d’été), je voudrais vous partager deux réflexions: sur l’épiclèse et sur l’octave de la Pentecôte.
Concernant l’épiclèse, on aime dire qu’il s’agit de l’invocation de l’Esprit Saint. En réalité, dans quasiment tous les rites et toutes les cérémonies où il y a une épiclèse, on ne s’adresse pas au Saint-Esprit. On demande au Père d’envoyer l’Esprit.
Les véritables rites occidentaux ont la spécificité de demander à l’Esprit lui-même de descendre sur les dons eucharistiques: Veni, sanctificator omnipotens æterne Deus : et benedic hoc sacrificium, tuo sancto nomini præparatum. – Viens, sanctificateur, Dieu tout-puissant et éternel, et bénis ce sacrifice, préparé pour ton saint nom.
D’où sait-on que c’est l’Esprit-Saint qui est invoqué ici? La preuve, nous l’avons dans le rite lyonnais, où l’épiclèse est double: sur le dons et sur le peuple: après la formule citée ci-dessus, le prêtre dit la suivante: Veni, sancte Spiritus : reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende. – Viens, saint Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour.
Maintenant, concernant l’octave de la Pentecôte, d’aucuns ont estimé – contrairement à toute l’histoire de l’Église – que la fête de la Pentecôte ne devrait pas avoir d’octave. Dans la pratique, ça donne ceci: civilement, nous avons un lundi de la Pentecôte, mais dans les églises de nos villages, si jamais il y a une Messe, c’est une Messe « du temps ordinaire ». La raison invoquée, c’est le nombre de 50. Oui, 50 jours de la Pâque à la Pentecôte.
Que la Pentecôte tombe 50 jours après la Pâque est un fait. Mais qu’on ne puisse pas dépasser ces 50 jours dans la fête, est une contre-vérité historique.
Le christianisme est l’héritier légitime du judaïsme. La Pentecôte est la deuxième fête, selon l’importance. Et les apôtres ont gardé cette fête (Actes 20:16, I Corinthiens 16:8). Or, dans la diaspora juive, la Pentecôte durait 2 jours. De surcroît, chez les Karaïtes – qui gardent la coutume ancienne – la Pentecôte tombe toujours un dimanche, et le lundi suivant.
Dji n’ sai nén si vos avoz l’ minme sacwè k’ nozôtes; mins dispoy on ptit timp, dji rçuvans bråmint des « bistokes » pal posse.
Po cmincî, ç’ a stî l’ Rodje Creujhe di Beldjike ki nos a evoyî des cizetes et des faxhetes, tot bribant des cwårs. Si vos vos rmimbrez, dj’ elzî a scrît, et les evoyî å sete-cints djaeyes.
Dispoy ene samwinne, c’ esteut Mamas For Africa, poy Sensorial Handicap Cooperation, et po fini Action Damien.
On fwait shonnance di vs diner ene bistoke, ki c’ est cwand po vos stoide foû vos çanses!
Dji vou bén fé l’ tchårité, mins nén insi.
Dj’ elzî a respondou a zels eto:
Lorsque les albums Load et Reload sont sortis, j’ai vraiment eu du mal avec certaines chansons. Par exemple, tout fan de Metallica que j’étais (ou je suis?) je n’ai pas réussi à digérer la chanson « Fuel », avant que j’en entende la version d’Avril Lavigne (il y a dix ans déjà!). Oui, Avril Lavigne, avec ses musiciens efféminés, peut faire, parfois, cependant seulement en matière de métal, un travail meilleur que les métalleux.
Comme quoi, parfois les copies sont plus réussies que les originaux. Est-ce un paradoxe? Ou bien ce sont les œuvres d’art qui évoluent au fur et à mesure qu’elles passent d’un artiste à l’autre? C’est ainsi que s’accomplit la collaboration intergénérationnelle et transgénérationnelle.
Il y a deux ans, le mardi de la Pentecôte, nous étions à la Messe à l’Église Saint-Anschaire de Stockholm. Chaque fois que nous étions à la Messe en Suède, nous étions apaisés pour deux raisons:
1. D’une part, nous pouvions nous embrasser et/ou nous tenir par la main pendant la Messe, comme les autres couples, sans qu’on nous regarde de travers, sans qu’on craigne qu’on nous refuse la communion…
2. D’autre part, ces célébrations n’étaient pas pour autant clownesques, ni de mauvais goût, ni relativistes… Le corps et le sang du Christ nous étaient donnés en grande hospitalité eucharistique, dignement, sous les deux espèces.
Sur le site de l’Église vieille-catholique hollandaise j’apprends que l’Union d’Utrecht et l’Église suédoise viennent d’avoir la dernière session théologique commune, en vue de la pleine communion.
En même temps, les sites des quelques paroisses vieilles-catholiques suédoises n’existent plus. À vrai dire, je me demande si ces paroisses-là ont encore une raison d’être, si pleine communion il y a.
 Ci-contre, la Messe, présidée par l’épiscopesse Antje Jackelén dans le village de Vanstad.
Ci-contre, la Messe, présidée par l’épiscopesse Antje Jackelén dans le village de Vanstad.
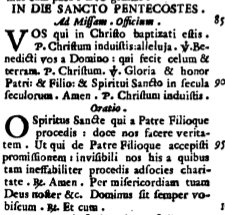 Il est intéressant de remarquer comment, même en la fête de la Pentecôte, la liturgie romaine reste extrêmement timide face à l’invocation du Saint-Esprit.
Il est intéressant de remarquer comment, même en la fête de la Pentecôte, la liturgie romaine reste extrêmement timide face à l’invocation du Saint-Esprit.
Le rite byzantin a quelques antiennes adressées au Saint-Esprit en cette fête; mais même le tropaire du jour est adressé au Christ, et pas à l’Esprit.
Dans le rite mozarabe, heureusement, la collecte du jour est adressée à l’Esprit Saint. De même les post-pridie de la vigile et du jour, ainsi que l’introduction au Notre Père le jour de la Pentecôte: toutes ces parties sont adressées au saint-Esprit.
Le site suédois moderne a, lui aussi, pour ce jourd’hui, à côté de la collecte traditionnelle du rite romain, une collecte suédoise moderne, adressée à l’Esprit Saint.
À ma connaissance, quasiment tous les canons eucharistiques de par le monde sont adressés au Père, sauf l’anaphore de saint Grégoire de Nazianze (copte) au Fils; mais aucun à l’Esprit Saint…
 Hier soir, nous avons regardé l’Eurovision. L’édition de cette année-ci m’a semblé beaucoup meilleure que les années précédentes. Notamment, plusieurs concurrents ont chanté en leur langue nationale, et pas en anglais.
Hier soir, nous avons regardé l’Eurovision. L’édition de cette année-ci m’a semblé beaucoup meilleure que les années précédentes. Notamment, plusieurs concurrents ont chanté en leur langue nationale, et pas en anglais.
Pour la première fois, Nicolas et moi sommes d’accord en disant que le meilleur a été le contre-ténor Florin-Cezar Ouatu (Roumanie) avec sa chanson It’s My Life; nous avons également apprécié Aliona Munteanu (Rép. Moldavie) avec sa chanson 1000, ainsi que Eyþór Ingi fils de Gunnlaugur (Islande) avec Ég á líf. Personnellement, la chanson Contigo hasta el final du Sueño de Morfeo m’a plu aussi.
Nous n’avons pas apprécié le barakî Roberto Bellarosa, l’Italien Marco Mengoni, le Hongrois Alex Márta, ainsi que les Grecs… Et nous nous demandons toujours comment l’Azeri Fərid Məmmədov a pu arriver en deuxième position avec sa chanson Bana Dönsen.
Nous avons aimé la bonne organisation du concours par la Suède, et la bonne présentation par Petra Mede.
 Le thème de cette année-ci a été «les familles arc-en-ciel».
Le thème de cette année-ci a été «les familles arc-en-ciel».
Beaucoup pensent que ça, c’est une invention moderne ou post-moderne.
En réalité, contrairement à la caricature de sainte famille qu’on nous a présentée à partir des temps modernes, la première famille arc-en-ciel de l’histoire chrétienne a été la famille dans laquelle Jésus a grandi. L’opposition entre, d’une part, la théorie romaine et orientale (de la virginité perpétuelle de Marie), et, d’autre part, la théorie néo-protestante (qui prétend que les frères et sœurs de Jésus seraient des enfants de Marie) réside en une image erronée du concept de famille, des deux côtés. Autrement dit, les deux camps ont exclu le concept de famille recomposée, parce que ça ne correspondait à leur agenda (commune) concernant ce que devrait être la famille chrétienne.
Qu’est-ce, donc, la sainte famille? Une famille recomposée, à partir du vieillard Joseph le veuf et ses enfants, de l’adolescente Marie ayant un nouveau-né par parthénogenèse, et de la convivence de ceux-ci.