Il y a une petite anomalie liturgique dans les calendriers occidentaux traditionnels. Les quatre-temps d’automne ont lieu le mercredi, vendredi et samedi qui suivent la fête de l’Exaltation de la Sainte-Croix. Lorsque, par exemple, cette fête tombe un mardi, les trois jours de quatre-temps tombent dans l’octave de la fête (comme cela arrive avec les quatre-temps d’été qui tombent dans l’octave de la Pentecôte). Mais, lorsque, comme cette année-ci, la Sainte-Croix tombe un mercredi, alors les quatre-temps tombent une semaine plus tard, et n’ont donc pas de matériel liturgique propre (à moins que l’octave de saint Matthieu soit observée comme octave “majeure”).
En plus, dans certaines régions on observe le jeûne régional ou fédéral, qui, quoique calqué sur les quatre-temps, n’a pas de matériel liturgique propre.
Voilà pourquoi j’ai considéré approprié de traduire les deux hymnes de Fortunat, l’un pour les matines, l’autre pour la none d’un jour de jeûne. Là où l’ont chante vêpres plutôt que none, cette dernière est idéale pour les secondes vêpres. À noter que ces deux hymnes existent dans le rite mozarabe, où elles sont chantées en carême.
O Nazarene
Ô Nazaréen, du Père es Verbe et radiance;
Bethléemien, de la femme es descendance;
Christ, sereinement agrée nos observances,
Ô roi, regarde le peuple qui s’avance
En fêtes, louanges, jeûnes, abstinences.
2. Donne-nous d’observer le jeûne, ce mystère,
Qu’il purifie nos cœurs de toute misère,
Qu’il chasse l’intempérance des viscères,
Que dans le corps le surplus non-nécessaire
N’étrangle la raison en la faisant taire.
3. Donc, guéris, Seigneur, le luxe et la gourmandise,
L’excès de sommeil et de boissons qui grisent;
Arrache tous les vices et les sottises,
Et que par ta discipline soient soumises
Langueurs et paroles que nos langues disent.
4. Tout en retranchant les boissons et nourriture,
Règle nos membres par l’abstinence pure;
Fais que les réjouissances qui ne perdurent
N’éteignent pas notre intelligence sûre,
Que l’âme ne dorme en un corps sans mesures.
5. Ô Dieu, mets un frein à tout ce qui est cupide,
Et que la prudence soit à nouveau splendide,
Et rends l’esprit perspicace et intrépide;
Ainsi, la prière sera plus limpide,
Ô créateur des esprits et corps solides.
18. Ô Maître, donne-nous d’atteindre cette cible
Que tu as proposée, Christ, à tes disciples,
Que nous jeûnions, à ton exemple crédible,
Et qu’en triomphant sur les passions multiples,
L’esprit, l’âme et le corps soient compatibles.
19. Oh, par le jeûne, Dieu du ciel et de la terre,
Chasse au loin les démons qui nous font la guerre,
Fais-nous entrer à ton autel de lumière,
Réveille les somnolents au cœur de pierre,
Redonne aux malades une santé claire.
21. Accorde-nous, Seigneur, un jeûne charitable,
Pour partager vêtements et mets de table
Et une oreille à ceux que la vie accable,
Afin d’établir ce qui est équitable
Parmi les gens que tu as créés semblables.
Gloire à toi, Dieu le Fils qui es d’avant les âges,
Qui, devenu humain, et plein de courage,
Jeûnas quarante jours sans mets, sans breuvage!
Esprit, Père et Fils, un Dieu en trois visages,
À toi, dans les siècles, gloire et tout hommage! Amen.
Christe servorum
Christ, roi et maître des gens, tes fidèles,
Qui nous mets un frein avec modération,
Tu nous as prescrit, selon ton modèle,
Les jeûne et ration.
2. Tu es l’exemple pour tous ceux qui jeûnent,
Toi qui as porté les fardeaux en ton corps,
Aujourd’hui t’ont suivi les vieux et jeunes,
Les faibles et forts.
3. Mais le soir tombe; le soleil se couche,
Et son bel éclat a presque disparu;
La nuit et le jour, l’un l’autre se touchent:
La clarté n’est plus.
9. Donc si une ouaille du troupeau s’affole,
Le pasteur, cherchant cette brebis perdue,
La trouve et la prend sur ses deux épaules
Avec des soins dus.
13. Ô mon bon pâtre, qui sauves pas grâce,
Nous ne pouvons rien, rien pour te rembourser:
Ni jeûnes, ni vœux, ni quoique l’on fasse
Comme œuvres poussées.
17. Tu acceptes le jeûne ou l’abstinence,
Pour notre grand bien, non pas pour la terreur,
Stricte ou relâché, en bonne conscience,
Pour guérir l’erreur.
20. Seigneur, s’il te plaît, que la nourriture
Qui sera mangée par nos corps las tantôt
Soit pour la santé et la belle allure
Des chrétiens dévôts. Amen.















 L’une des choses qui m’horrifie le plus dans la plupart des églises de rite byzantin, c’est l’iconostase. Il s’agit d’un “mur d’icônes” qui sépare le sanctuaire d’avec la nef. Dans la pratique, c’est l’un des moteurs de la désacralisation de la vie chrétienne dans les pays concernés: les fidèles sont tenus, à cause de l’iconostase, tellement à l’écart des sacrements, que la plupart d’entre eux ne savent même pas que lors la Messe il y a du pain et du vin qui sont consacrés. L’iconostase est la cause directe de la disparition de la conscience ecclésiale et eucharistique! Une petite visite dans les pays de l’Est et dans les Balkans vous donnera à voir des gens qui communient une seule fois par an, en carême, et cela même en dehors de la Messe.
L’une des choses qui m’horrifie le plus dans la plupart des églises de rite byzantin, c’est l’iconostase. Il s’agit d’un “mur d’icônes” qui sépare le sanctuaire d’avec la nef. Dans la pratique, c’est l’un des moteurs de la désacralisation de la vie chrétienne dans les pays concernés: les fidèles sont tenus, à cause de l’iconostase, tellement à l’écart des sacrements, que la plupart d’entre eux ne savent même pas que lors la Messe il y a du pain et du vin qui sont consacrés. L’iconostase est la cause directe de la disparition de la conscience ecclésiale et eucharistique! Une petite visite dans les pays de l’Est et dans les Balkans vous donnera à voir des gens qui communient une seule fois par an, en carême, et cela même en dehors de la Messe. Je trouve qu’en Occident, nous avons trois alternatives historiques, pratiques et pastorales à cela:
Je trouve qu’en Occident, nous avons trois alternatives historiques, pratiques et pastorales à cela: 2. Le banc de communion. Là où il y a un jubé, le banc de communion se trouve entre l’autel et le jubé, ce qui démontre que le rôle du jubé n’est pas d’éloigner les fidèles. Là où il n’y a pas de jubé, le banc de communion tient la place de celui-là. Comme dans l’image ci-contre (cathédrale du Groenland), le banc de communion n’empêche nullement les fidèles de regarder l’autel; d’ailleurs, l’autel est plus élevé, comme son étymologie l’indique.
2. Le banc de communion. Là où il y a un jubé, le banc de communion se trouve entre l’autel et le jubé, ce qui démontre que le rôle du jubé n’est pas d’éloigner les fidèles. Là où il n’y a pas de jubé, le banc de communion tient la place de celui-là. Comme dans l’image ci-contre (cathédrale du Groenland), le banc de communion n’empêche nullement les fidèles de regarder l’autel; d’ailleurs, l’autel est plus élevé, comme son étymologie l’indique. 3. Le retable. Avant le début de la Messe, on ouvre le retable, qui est une sorte de triptyque d’icônes. Le panneau central repose sur l’autel, alors que les deux panneaux latéraux y sont réunis par des charnières. Ainsi, pendant la Messe, tout le peuple – clergé et laïcs – sont orientés à la fois vers l’autel et vers les icônes. Le retable nous fait entrer dans le mystère de Dieu et de l’eschaton, sans obstruer la vue.
3. Le retable. Avant le début de la Messe, on ouvre le retable, qui est une sorte de triptyque d’icônes. Le panneau central repose sur l’autel, alors que les deux panneaux latéraux y sont réunis par des charnières. Ainsi, pendant la Messe, tout le peuple – clergé et laïcs – sont orientés à la fois vers l’autel et vers les icônes. Le retable nous fait entrer dans le mystère de Dieu et de l’eschaton, sans obstruer la vue. Car ces panneaux latéraux ont également deux icônes sur le verso. Il s’agit de l’Annonciation. Dans les églises byzantines aussi, c’est l’Annonciation qui est peinte sur les “portes royales”. Cela veut dire qu’en dehors de célébration eucharistique, nous voyons seulement la “couverture”, la scène de début, du livre de l’incarnation. Avec l’apparition de crucifix, bougeoirs géants et tabernacles immenses sur l’autel, on a du mal à fermer le retable après la Messe; du coup, malheureusement, dans la pratique, les retables restent ouverts tout le temps, et l’Annonciation n’est jamais visible.
Car ces panneaux latéraux ont également deux icônes sur le verso. Il s’agit de l’Annonciation. Dans les églises byzantines aussi, c’est l’Annonciation qui est peinte sur les “portes royales”. Cela veut dire qu’en dehors de célébration eucharistique, nous voyons seulement la “couverture”, la scène de début, du livre de l’incarnation. Avec l’apparition de crucifix, bougeoirs géants et tabernacles immenses sur l’autel, on a du mal à fermer le retable après la Messe; du coup, malheureusement, dans la pratique, les retables restent ouverts tout le temps, et l’Annonciation n’est jamais visible. Cela ne fait qu’amoindrir le caractère eschatologique de la Messe.
Cela ne fait qu’amoindrir le caractère eschatologique de la Messe. Joyeuses noces de lin, mon amour!
Joyeuses noces de lin, mon amour!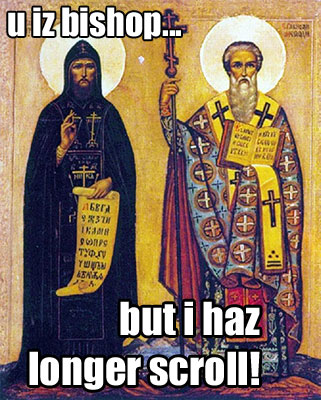 Dans cet article, je voudrais parler de l’ecclésiologie eucharistique. Comme je le dis souvent, c’est dans la liturgie qu’il faut chercher la doctrine de l’Église. Donc, si l’on veut savoir ce que l’Église croit à propos d’elle-même, on doit interroger la liturgie.
Dans cet article, je voudrais parler de l’ecclésiologie eucharistique. Comme je le dis souvent, c’est dans la liturgie qu’il faut chercher la doctrine de l’Église. Donc, si l’on veut savoir ce que l’Église croit à propos d’elle-même, on doit interroger la liturgie. J’entends des voix qui s’élèvent dans le christianisme occidental pour demander l’instauration d’une « saison de la création », sous prétexte que le patriarche œcuménique de Constantinople ait fait la même chose pour son Église. Qu’en est-il ?
J’entends des voix qui s’élèvent dans le christianisme occidental pour demander l’instauration d’une « saison de la création », sous prétexte que le patriarche œcuménique de Constantinople ait fait la même chose pour son Église. Qu’en est-il ? 2. Il existe déjà en Occident une “saison de la création” : c’est le temps de la septuagésime. Autant dans les bréviaires romains anciens que dans le Book of Common Prayer de 1662, le dimanche de la Septuagésime on entame la lecture du livre de la Genèse. Plusieurs rites orientaux ont ça aussi, et le rite byzantin, avant de subir une monasticisation du carême, avait cela aussi. Donc, on n’a qu’à observer tant qu’on veut la saison de la septuagésime. Et le rite byzantin ferait bien de revenir à ses propres sources.
2. Il existe déjà en Occident une “saison de la création” : c’est le temps de la septuagésime. Autant dans les bréviaires romains anciens que dans le Book of Common Prayer de 1662, le dimanche de la Septuagésime on entame la lecture du livre de la Genèse. Plusieurs rites orientaux ont ça aussi, et le rite byzantin, avant de subir une monasticisation du carême, avait cela aussi. Donc, on n’a qu’à observer tant qu’on veut la saison de la septuagésime. Et le rite byzantin ferait bien de revenir à ses propres sources. 3. Il existe déjà dans l’Église quatre périodes, héritées de l’Ancien Testament, où, aux quatre saisons, les chrétiens rendent grâces à Dieu pour ses bienfaits souvent liés aux saisons : ce sont les quatre-temps de printemps, d’été, d’automne et d’hiver. Comme le premier et le dernier de la liste se superposent avec des saisons apparues plus tard (carême et avent), ce sont les quatre-temps d’été et d’automne qui sont les plus propices à rendre grâce à Dieu pour les moissons et les récoltes. Maintenant, au mois de septembre, si quelqu’un veut faire quelque chose pour l’environnement, qu’il observe scrupuleusement le jeûne et l’abstinence des quatre-temps d’automne, et la chose est réglée. Pour intercéder pour l’environnement, l’Église a déjà quelque chose depuis un millénaire et demi : la grande rogation du 25 avril et les trois petites rogations avant la fête de l’Ascension.
3. Il existe déjà dans l’Église quatre périodes, héritées de l’Ancien Testament, où, aux quatre saisons, les chrétiens rendent grâces à Dieu pour ses bienfaits souvent liés aux saisons : ce sont les quatre-temps de printemps, d’été, d’automne et d’hiver. Comme le premier et le dernier de la liste se superposent avec des saisons apparues plus tard (carême et avent), ce sont les quatre-temps d’été et d’automne qui sont les plus propices à rendre grâce à Dieu pour les moissons et les récoltes. Maintenant, au mois de septembre, si quelqu’un veut faire quelque chose pour l’environnement, qu’il observe scrupuleusement le jeûne et l’abstinence des quatre-temps d’automne, et la chose est réglée. Pour intercéder pour l’environnement, l’Église a déjà quelque chose depuis un millénaire et demi : la grande rogation du 25 avril et les trois petites rogations avant la fête de l’Ascension. 4. On ne peut pas avoir une “saison de l’environnement”, de la même façon que l’on ne peut pas avoir une fête du “sacré-cœur” de Jésus, ni de “fête de l’amour”. Les fêtes liturgiques sont toutes – et doivent être – des commémoraisons de quelque chose qui s’est passé dans le passé.
4. On ne peut pas avoir une “saison de l’environnement”, de la même façon que l’on ne peut pas avoir une fête du “sacré-cœur” de Jésus, ni de “fête de l’amour”. Les fêtes liturgiques sont toutes – et doivent être – des commémoraisons de quelque chose qui s’est passé dans le passé. 6. Une fête de l’environnement n’est qu’un prétexte pour se donner bonne conscience. Un peu comme quand quelqu’un met cinq euros dans une collecte de carême pour l’Afrique, pour ne plus rien faire d’autre le reste de l’année. J’ai déjà été présent à un week-end chrétien pour l’environnement, et à part les diaporamas et le blabla, ça n’avait rien à voir avec l’environnement : la nourriture servie était totalement anti-écologique, la gestion des déchets de l’événement aussi. Ce n’est pas une « saison de la création » qui va nous sauver du réchauffement climatique.
6. Une fête de l’environnement n’est qu’un prétexte pour se donner bonne conscience. Un peu comme quand quelqu’un met cinq euros dans une collecte de carême pour l’Afrique, pour ne plus rien faire d’autre le reste de l’année. J’ai déjà été présent à un week-end chrétien pour l’environnement, et à part les diaporamas et le blabla, ça n’avait rien à voir avec l’environnement : la nourriture servie était totalement anti-écologique, la gestion des déchets de l’événement aussi. Ce n’est pas une « saison de la création » qui va nous sauver du réchauffement climatique. Une “saison de la création” dans le calendrier chrétien, c’est un doigt que l’on se fout dans l’œil. La toute première chose qu’un humain simple peut faire pour agir pour la préservation de l’environnement, c’est de devenir végétalien. Une “saison de la création” dans le calendrier chrétien, c’est de la grâce à bon marché. Pour citer Bonhœffer, «Dans cette Église le monde trouve, à bon marché, un voile pour couvrir ses péchés, péchés dont il ne se repent pas et dont, à plus forte raison, il ne désire pas se libérer. De ce fait, la grâce à bon marché est la négation de la Parole vivante de Dieu, la négation de l’incarnation de la Parole de Dieu. La grâce à bon marché, c’est la justification du péché et non point du pécheur. Puisque la grâce fait tout toute seule, tout n’a qu’à rester comme avant.»
Une “saison de la création” dans le calendrier chrétien, c’est un doigt que l’on se fout dans l’œil. La toute première chose qu’un humain simple peut faire pour agir pour la préservation de l’environnement, c’est de devenir végétalien. Une “saison de la création” dans le calendrier chrétien, c’est de la grâce à bon marché. Pour citer Bonhœffer, «Dans cette Église le monde trouve, à bon marché, un voile pour couvrir ses péchés, péchés dont il ne se repent pas et dont, à plus forte raison, il ne désire pas se libérer. De ce fait, la grâce à bon marché est la négation de la Parole vivante de Dieu, la négation de l’incarnation de la Parole de Dieu. La grâce à bon marché, c’est la justification du péché et non point du pécheur. Puisque la grâce fait tout toute seule, tout n’a qu’à rester comme avant.»
 « Que ton règne vienne. » L’Église est déjà, d’une certaine manière, l’avénement du royaume de Dieu. Mais c’est par le baptême que nous devenons membres de l’Église. Même si, de façon dynamique, c’est dans l’Eucharistie que l’Église se constitue, néanmoins, de manière statique, c’est par le baptême que l’Église se multiplie sur la terre. Le règne de Dieu se manifeste, pour la première fois, à chaque humain, lors de son baptême.
« Que ton règne vienne. » L’Église est déjà, d’une certaine manière, l’avénement du royaume de Dieu. Mais c’est par le baptême que nous devenons membres de l’Église. Même si, de façon dynamique, c’est dans l’Eucharistie que l’Église se constitue, néanmoins, de manière statique, c’est par le baptême que l’Église se multiplie sur la terre. Le règne de Dieu se manifeste, pour la première fois, à chaque humain, lors de son baptême.
 « Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien/essentiel. » Comme les Pères de l’Église l’ont vu et expliqué, il s’agit de l’Eucharistie.
« Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien/essentiel. » Comme les Pères de l’Église l’ont vu et expliqué, il s’agit de l’Eucharistie. « Remets-nous nos dettes », ou « pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » C’est dans le sacrement de la pénitence que nous recevons l’absolution. Avant de recevoir l’absolution, il nous est demandé d’avoir pardonné aux autres, et de ne pas être querellés avec les autres.
« Remets-nous nos dettes », ou « pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » C’est dans le sacrement de la pénitence que nous recevons l’absolution. Avant de recevoir l’absolution, il nous est demandé d’avoir pardonné aux autres, et de ne pas être querellés avec les autres.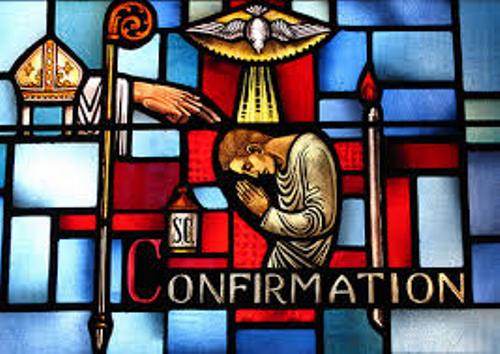 « Et ne nous soumets pas à la tentation. » C’est le sacrement de la chrismation/confirmation qui nous est conféré pour nous aider dans le combat spirituel. L’Esprit-Saint nous est donné de façon particulière dans la confirmation, et c’est lui « la force d’en haut ». Comme dit la séquence à l’Esprit-Saint : « Sans ton aide et ta bonté / De vrais biens l’homme est privé, / Et demeure en son péché. // […] Fais fléchir notre raideur, / Oh, réchauffe nos froideurs, / Et redresse les erreurs. »
« Et ne nous soumets pas à la tentation. » C’est le sacrement de la chrismation/confirmation qui nous est conféré pour nous aider dans le combat spirituel. L’Esprit-Saint nous est donné de façon particulière dans la confirmation, et c’est lui « la force d’en haut ». Comme dit la séquence à l’Esprit-Saint : « Sans ton aide et ta bonté / De vrais biens l’homme est privé, / Et demeure en son péché. // […] Fais fléchir notre raideur, / Oh, réchauffe nos froideurs, / Et redresse les erreurs. » « Mais délivre-nous du mal. » L’onction des malades non seulement remet au souffrant ses péchés véniels, mais elle le soulage dans tout mal, physique et spirituel, dans lequel il se trouve. Le mal peut être également la maladie, et dans de nombreux cas, c’est par le sacrement de l’onction des malades que Dieu a guéri les gens.
« Mais délivre-nous du mal. » L’onction des malades non seulement remet au souffrant ses péchés véniels, mais elle le soulage dans tout mal, physique et spirituel, dans lequel il se trouve. Le mal peut être également la maladie, et dans de nombreux cas, c’est par le sacrement de l’onction des malades que Dieu a guéri les gens.

 Le week-end passé, samedi-dimanche, Nicolas et moi-même fêtions nos 10 ans ensemble.
Le week-end passé, samedi-dimanche, Nicolas et moi-même fêtions nos 10 ans ensemble.