Samedi soir, nous avons été à une vigile pascale qui avait commencé à 17h30. Ainsi, après la célébration, nous avons eu le temps de rompre le jeûne avec un bon souper. (Ça m’aurait fait très mal d’aller au travail avec le ventre vide, et sans avoir fêté la Pâque également par un bon repas.)
Donc nous sommes allés manger au restaurant végétarien Dolma, situé à Ixelles, en bas de la chaussée d’Ixelles. Ce restaurant, tenu par des hindous, nous a impressionnés. Ils ont une certaine variété dans les plats, et la grande majorité de leurs recettes sont végétaliennes.
Il est curieux de voir que les employés sont des Flamands, et que la clientelle semble majoritairement anglophone. C’est que, donc, les questions éthiques n’intéressent pas une certaine catégorie de Belges, et c’est bien dommage. Un resto végé fait faillite à Namur, un autre à Liége, tandis qu’à Charleroi il n’y en a jamais eu un.
Prochainement j’ai envie d’essayer le resto Slurps, toujours à Ixelles, dans la rue Dautzenberg. Et le prochain magasin végétalien où je voudrais faire du magasinage, c’est La Saga, à Etterbeek, dans l’avenue de la Chevalerie.
Comme quoi, une fois de plus, les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de la lumière!
Et à ce propos, je viens de découvrir le film LoveMEATender, un film belge de Manu Coeman (le jeu de mots est une coïncidence).



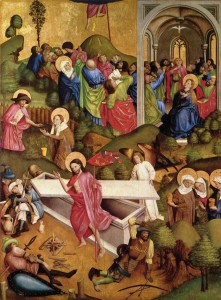

 Aujourd’hui, c’est la fête de sainte Agnès, vierge martyre. Deux variantes régionales de chez nous donnent Nanesse et Lemmeke (Lammeke).
Aujourd’hui, c’est la fête de sainte Agnès, vierge martyre. Deux variantes régionales de chez nous donnent Nanesse et Lemmeke (Lammeke).



